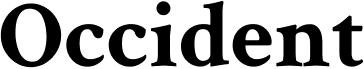Bruxelles, 07-13 juillet 2025 / 414
# Il y a 80 ans… Le 3ème Reich vaincu depuis deux mois, on préparait la conférence de Potsdam, qui se tiendrait dans un château au sud-ouest de Berlin, du 17 juillet au 2 août 1945. “L’atmosphère est beaucoup moins cordiale qu’à Yalta”. La guerre continue dans le Pacifique, face au Japon. (Occident 03-09022025+Encyclopaedia Britannica +CVCE -Université du Luxembourg)
# Extraits de “1945-2025. De la fin de la guerre à la paix menacée”, un riche Le Monde hors-série, n°96H de mai-juin 2025.
# “Le monde après 1945 doit être ouvert, démocratique, pacifique et coopératif.” Entretien avec l’historienne Sabine Jansen, professeure des universités, secrétaire générale de la Revue historique et co-rédactrice en chef de la revue Questions internationales : « (…) Le président américain Roosevelt parle d’un “monde libéré de la peur“. (…) Dès le 9 février 1946, (…) Staline annonce la renaissance de l’affrontement entre capitalisme et communisme. La mécanique de la guerre froide est enclenchée. (…) La dictature du prolétariat n’a rien à voir avec la démocratie libérale, et les deux systèmes seront en tension permanente. Ils n’éviteront l’affrontement direct que par la mise en œuvre de la guerre par délégation, par exemple en Corée [1950-1953] ou au Vietnam [1955-1975]. (…) Les Soviétiques perdent la guerre froide. Les Occidentaux s’imaginent l’avoir gagnée : erreur d’analyse. Pour ces derniers aussi, le réveil sera rude. (…) » (Lirsa -Paris+Cairn.info +Académie des Sciences Morales et Politiques -Institut de France+Les Rendez-vous de l’Histoire -Blois)
# “Le nouveau monde devient bipolaire.” L’historien Pierre Grosser, membre du Centre d’histoire de Sciences Po Paris, a publié en mars 2023 “L’autre guerre froide ? La confrontation États-Unis/Chine” (CNRS éditions) : « (…) Américains et Britanniques s’alarment de la volonté soviétique d’imposer son joug en Europe de l’Est, en Roumanie (…), ou en Pologne. (…) Avant son décès le 12 avril 1945, Roosevelt fait part de ses préoccupations. (…) dans les livres d’histoire soviétiques et désormais russes, c’est cette date qui marque le début de la guerre froide. Un président coopératif aurait été remplacé par son vice-président brutal et inexpérimenté, Truman, vite poussé à la confrontation par son entourage antisoviétique. (…) » (Persée +France Culture)
# “La crise diplomatique entre Américains et Européens est-elle le signe de la fin d’un Occident ou juste d’une défaillance du lien transatlantique ?” Question posée par le politologue Gaïd Minassian, responsable des hors-séries du Monde et de la conception éditoriale. Réponse de Laurence Badel, professeure d’histoire contemporaine des relations internationales à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, qui enseigne aussi l’histoire des pratiques diplomatiques à l’Académie diplomatique de Vienne, en Autriche. Elle a publié, l’année dernière chez Armand Colin, “Ecrire l’histoire des relations internationales. Genèses, concepts, perspectives, 18ème-21ème siècle” : « (…) C’est la fin, provisoire, d’une forme d’Occident. Le contenu de la notion est historiquement variable. Entre 1949 et 1991, l’Occident désigne l’Europe “occidentale”, les États-Unis et le Canada associés dans un système de défense commune dirigé de façon prioritaire contre le bloc communiste, système qui a permis le maintien de nombreuses forces américaines en Europe. (…) le non-respect du droit par les Occidentaux, leur politique du deux poids-deux mesures, leur cynisme parfois, dévaluent radicalement leurs grands discours dans le reste du monde. (…) Un nouvel Occident se recompose sous nos yeux. (…) » (Babelio +Linkedin +EHNE -Paris) ***