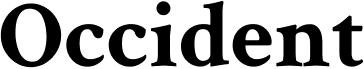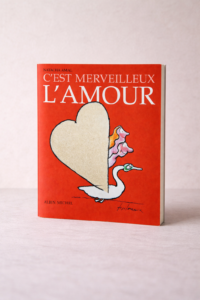Bruxelles, 01-06 avril 2025 / 402
# 5 avril 1975, décès du leader nationaliste chinois Tchang Kaï-chek, 50 ans après celui de Sun Yat-sen, le 12 mars 1925 (Occident 10-16032025+”La Grande histoire de la Chine”, Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, hors-série Histoire n°7 -décembre 2018-janvier 2019)
# “Ayant acquis des soutiens solides, Tchang Kaï-chek ne songe plus qu’à l’élimination des communistes.” Retrouvons le journaliste et homme politique français Claude Estier (1925-2016) avec son “Histoire de la Chine en 1000 images” (Robert Laffont/Pont Royal, 1966) : « (…) Tchang Kaï-chek, qui a 40 ans, va bientôt épouser Song Mayling, qui est la sœur de la veuve de Sun Yat-sen, ainsi que du gros financier T.V. Song. Tchang donne, ainsi, des gages, à la fois à la bourgeoisie et aux étrangers : son beau-frère, qui deviendra son ministre des Finances, est lié au capital américain ; sa femme, protestante, a été élevée aux Etats-Unis. (…) [il] s’efforce d’obtenir des Occidentaux qu’ils renoncent à leurs concessions et, surtout, à l’exterritorialité de celles-ci, afin de créer une infrastructure industrielle et chinoise. Mais les tractations n’aboutissent pas au résultat escompté, et si Shangaï connaît une certaine prospérité, c’est parce que l’Imperial Chemical Industries, l’I.G. Farben et la Standard Oil y ont, au contraire, accru leurs pouvoirs et leurs bénéfices. (…) »
# “Celui qui fut l’enfant chéri d’une certaine Amérique.” Dans Le Monde hors-série intitulé “Le siècle chinois” (octobre-novembre 2011) était reproduit un article datant du 6 mars 2000, signé par l’écrivain et journaliste Francis Deron (1952-2009), spécialiste de l’Asie : « (…) Tchang est l’homme de 1927, qui s’était gagné les faveurs des Occidentaux de droite tout en obtenant de Staline qu’il le laisse écraser dans le sang la révolution ouvrière ayant fait rage pendant deux ans à travers le pays. (…) d’avril 1947 à décembre 1949, les armées de Tchang sont taillées en morceaux par des troupes communistes portées par une réelle adhésion populaire (…). Le 8 décembre, ses ministres s’envolent pour Taïwan, (…) où, deux ans et demi plus tôt, le 28 février 1947, l’un des hommes-liges du généralissime (…) a en quelque sorte préparé le terrain en se rendant coupable d’un massacre à l’encontre de la population locale. (…) Dans la foulée de son repli, Tchang instaure la loi martiale à Taïwan. Elle durera près de 40 ans. (…) » (Mediapart)
# “Chiang Kai-shek, malheur aux vaincus.” Contribution de l’historien et sinologue Alain Roux pour le n°57 (octobre-décembre 2012) de la revue Les Collections de l’Histoire, titré “La Chine 1912-2012. D’un empire à l’autre” : « (…) Ayant participé activement à la révolution de 1911, il devient général à un peu plus de 30 ans (…). En 1943, à la conférence du Caire, il siégea aux côtés de Roosevelt et de Churchill pour coordonner les opérations de guerre contre le Japon. Avec Staline, il était un des quatre Grands. (…) Mais, vaincu par les communistes dirigés par Mao Zedong dans la guerre civile qui les opposait aux nationalistes du Guomindang [parti fondé par Sun Yat-sen en 1912], Chiang Kaï-shek se réfugia en décembre 1949 dans l’île de Taïwan et ne présida plus qu’une République de Chine réduite aux dimensions de la Belgique. (…) »
# “Les nationalistes continuaient à proclamer, surtout pour préserver les apparences, leur détermination à se battre pour revenir sur le continent.” Citons une nouvelle fois le sinologue américain John King Fairbank (1907-1991) dans “La Grande Révolution chinoise, 1800-1989” (Champs Flammarion, 1997) : « (…) En 1948, les Américains considéraient que les nationalistes ne pouvaient pas vaincre le PCC [Parti communiste chinois], mais que le PCC ne pouvait pas non plus triompher des nationalistes. (…) Le fait que la République chinoise nationaliste survivait à Taïwan, située à 200 km du continent, compromettait évidemment le bien-fondé de la revendication du PCC à représenter le gouvernement unifié de la Chine tout entière. (…) » ***